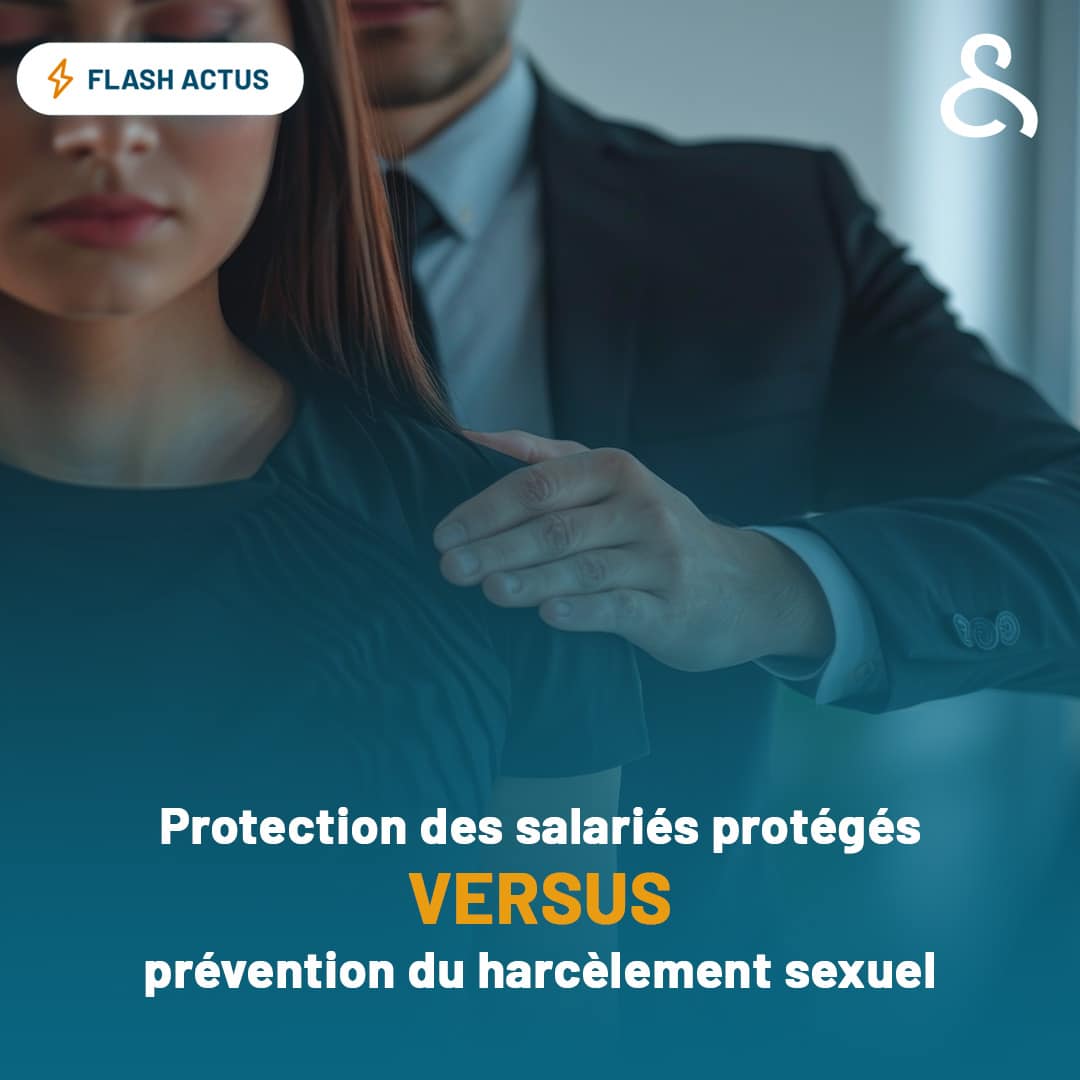Cette affaire en est une parfaite illustration.
À l’été 2009, un salarié avait été engagé par une association dont il avait été nommé, 7 ans plus tard, délégué syndical.
Après qu’une salariée du même établissement l’ait dénoncé à la direction de l’établissement pour comportement déplacé, à savoir des avances et gestes indécents à connotation sexuelle, le délégué syndical s’était vu notifier une mise à pied conservatoire, avant d’être convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 14 février 2017, l’inspection du travail avait toutefois refusé l’autorisation de licenciement, obligeant l’employeur à déférer sa décision au Tribunal administratif, tout en maintenant le salarié en mise à pied, par mesure de précaution.
Un mois plus tard, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, considérant qu’il aurait dû être réintégré dans son emploi.
Chassé-croisé de décisions des deux Ordres…
Le 20 septembre 2017, la juridiction administrative a annulé la décision de l’inspecteur du travail.
Les juridictions de l’ordre judicaire (le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel) se sont, pour leur part, prononcées en 2023 en faveur du salarié protégé.
La Cour d’appel avait certes retenu que plusieurs salariées avaient dénoncé des comportements inappropriés de la part du délégué syndical, tels que des gestes insistants, des contacts physiques non sollicités où des remarques révélant un intérêt particulier.
Toutefois, pour retenir que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul (et allouer au salarié une somme totale de l’ordre de 70.000 € !), la Cour d’appel avait estimé que ces éléments ne caractérisaient pas une impossibilité absolue de réintégration et que, par conséquent, le refus de réintégration opposé par l’employeur, malgré la décision de l’administration du travail, constituait une violation du statut protecteur du salarié, justifiant la rupture du contrat de travail.